Critiques virulentes, menaces de mort: comment les éditeurs de mangas se protègent contre le cyberharcèlement
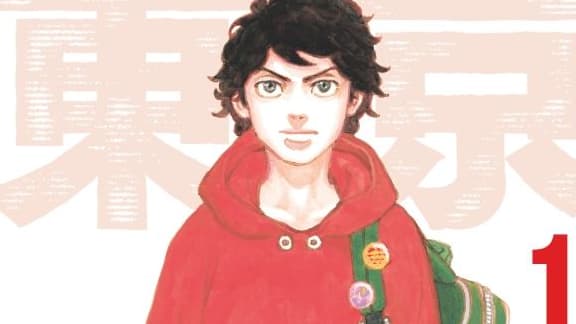
Détail de la couverture du premier tome de "Tokyo Revengers". La traduction française a provoqué une vague de harcèlement sur le traducteur et l'attachée de presse à l'époque de la sortie. - Glénat
"Pika, on vous pisse toujours dessus, ça ne changera jamais", "Envie de tabasser Pika, leur trad' est ignoble", "Pika, donne nous nos collectors ou on vient brûler vos locaux"... Ce genre de messages, Pika, l'éditeur français de L'Attaque des Titans, en reçoit tous les jours. Tout comme leurs confrères de Glénat, Delcourt/Tonkam, Kurokawa, Kana ou Mangetsu.
Il suffit parfois d'un mot mal traduit, d'un papier un peu plus transparent que d'ordinaire ou d'une frise mal agencée sur le dos d'un ouvrage pour déclencher l'ire de certains lecteurs. Des "vagues de haine récurrentes" qui, selon une figure d'une grande maison d'édition, contribue à brouiller l'image du manga alors que la grande majorité de ses consommateurs "sont avant tout bienveillants".
"C'est un phénomène très récent qui a débuté vers 2019", explique Matthieu Pinon, auteur de Manga, que d'histoires! (Larousse). "J'associe ça à un autre phénomène: la forte segmentarisation des fans de mangas. Plus une communauté sera petite sur les réseaux sociaux, plus elle voudra montrer qu'elle s'y connaît mieux que les éditeurs et plus elle voudra lui faire la leçon."
"Ça s'est accentué depuis le confinement", précise encore le community manager (CM) d'une maison d'édition. "Avant, il y avait une certaine entente entre les maisons d'édition et les lecteurs. Ils étaient satisfaits de notre travail. Maintenant, si on se fie aux réseaux sociaux, on est des monstres attirés par l'argent et tout ce qu'on fait est de la merde. On a l'impression en les lisant qu'on le fait sciemment - alors que non."
La faute à Twitter
L'inflation doublée de l'augmentation des prix (liées à la hausse des coûts des matières premières), alors que le manga connaît en France un nouvel âge d'or en termes de publication, explique cette crispation des relations entre les éditeurs et une partie des consommateurs. "On commence à être moins accessibles, alors que le manga est un art accessible. Cette dichotomie crée du ressentiment", note un CM.
"Twitter est aussi responsable de beaucoup de choses", note le responsable communication d'une grande maison d'édition. "Grâce aux réseaux sociaux, il y a à présent un lien direct entre des gens protégés par l’anonymat et des professionnels. Même quand un seul individu n'est pas content, il peut y avoir un effet boule de neige et ça peut vite prendre de l’ampleur."
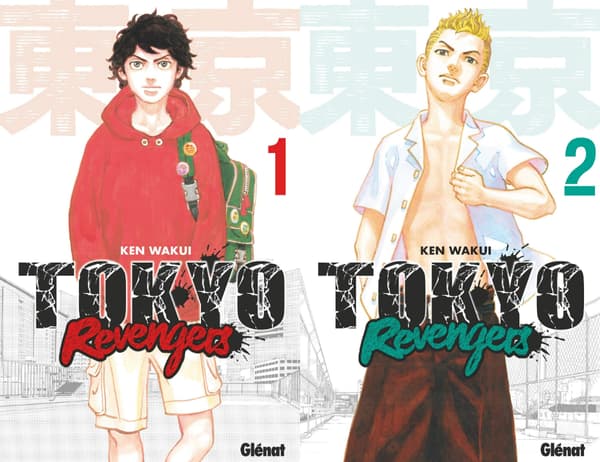
Ces vagues de harcèlement viennent souvent d'une profonde méconnaissance du monde de l'édition et du marché, insiste Matthieu Pinon. "Ils occultent le fait que les éditeurs français doivent dealer avec les contraintes des éditeurs japonais. Leur cahier des charges est monstrueux - et confidentiel. Ils ne lâchent rien et les Français sont obligés de s'y plier."
En 2019, la sortie de Tokyo Revengers a ainsi suscité des débordements dont une campagne de harcèlement à l'encontre du traducteur de la série et de l'attachée de presse de l'éditeur Glénat. A l'origine de ce déchaînement de violence: certains amateurs de "furyo" (mangas qui mettent en scène des délinquants) jugeant inexacts des choix de traduction.
La faute à certaines licences
Quelques années auparavant, Glénat avait dû gérer le "katakurigate", du nom d'un personnage de One Piece baptisé dans la traduction française "Dent de chien" - ce qui avait provoqué la colère de fans habitués aux versions pirates où le nom n'est pas traduit. "Une adaptation ne plaît jamais à 100%", sourit Satoko Inaba, directrice éditoriale de Glénat Manga, avant d'ajouter:
"Et parfois, des personnes non-japonisantes affirment haut et fort des choses totalement fausses. Certains voudraient même que des termes ne soient pas traduits - comme "nakama" ("compagnon") - alors que ce sont juste des mots communs. Ça pourrait vite devenir illisible si on ne les traduisait pas."
One Piece, L'Attaque des Titans ou Jujutsu Kaisen comptent parmi les licences les plus susceptibles de déchaîner des vagues de harcèlement: "Certaines licences font que les gens n'ont plus de filtre et se lâchent", confirme le CM d'un grand groupe. "C'est vraiment le cliché des grosses communautés de fans de shonen", ajoute un autre CM. "Plus il y a de monde dans la communauté, plus il y aura des personnes toxiques."
Des gifs de personnes décapitées
Au mieux, les insultes se contredisent. "Le même jour, j'ai reçu 'bande de féminazies' et 'bande de gros misogynes'. À choisir, je préfère être misandre", ironise ce CM. Au pire, ce sont des appels à brûler les maisons d'édition. "On en a reçu un comme ça deux ans jour pour jour après l'incendie du studio Kyoto Animation", se remémore encore ce CM. Plusieurs maisons d'édition confirment avoir reçu des messages identiques.
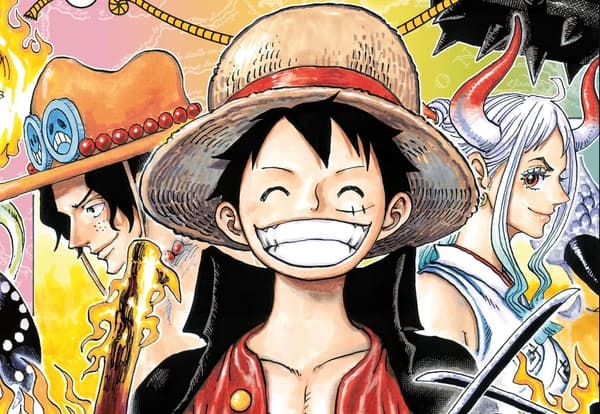
Une attachée de presse se souvient d'avoir reçu il y a quelques années des images de kalachnikov dans la messagerie privée de son éditeur sur X: "On avait pris des décisions qui étaient liées à un marché et des validations qu'on n'avait pas eues. Quand on avait communiqué sur ces décisions, il y avait eu une vague de mécontentements et certains avaient commencé à nous menacer."
"On a aussi reçu des gifs de personnes décapitées", complète cette chargée de communication. "Ils disaient que c'était nous, que c'est ce qui allait nous arriver et qu'ils iraient nous voir sur notre stand. Heureusement, ça n'est jamais allé plus loin. Notre erreur, à l'époque, a été de prendre ça un peu à la légère." Depuis, elle a quitté le monde de l'édition du manga.
"Agression à sens unique"
Ces messages ne servent pas uniquement à "laisser éclater sa colère", précise un responsable communication d'une maison d'édition. Certains fans vont jusqu'à faire fuiter contre leur volonté l'identité des CM et des attachés de presse: "Il y a un côté 'stalking' très préoccupant. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Derrière un pseudo, il peut y avoir quelqu'un qui ne fera jamais rien comme un vrai psychopathe."
"Pour moi, ce qui a été difficile à vivre, c'est l'impuissance face à une agression à sens unique, car je n'avais pas accès à leur identité", complète-t-il. "Et comme je ne suis pas un personnage public, en dévoilant publiquement mon nom, ils ont exercé un pouvoir sur mon identité. Ça, encore aujourd'hui, ça me pose problème car le harcèlement reste sur Internet. Mon nom sera éternellement associé à ces types sur Twitter."
"Ils n'ont pas conscience que derrière les comptes d'éditeurs, il y a des humains qui ne sont pas décisionnaires", ajoute un autre ancien chargé de communication du milieu. "Même si ce harcèlement et ses menaces ne sont pas ciblés sur la personne qui gère le compte, mais sur la boîte, c'est normal de se sentir concerné: comme on est présent sur des événements, on a peur de se faire insulter, baffer ou frapper sur notre stand."
Législation limitée
Cette violence est pour l'heure toujours restée virtuelle en France. Mais plus aucune maison d'édition ne prend ces menaces à la légère. "Il suffit que ça arrive une fois pour que ça incite d'autres à le faire", s'inquiète cette figure du milieu. "En interne, les responsables sont toujours tenus au courant. Je remonte tous les messages", glisse le CM d'une maison d'édition qui a réussi depuis seulement deux ans à "prendre du recul".
De la prévention est aussi faite en amont. "On prévient dès le départ les employés que s'ils apparaissent sur les réseaux, il y a des risques. Certains ne souhaitent d'ailleurs pas se montrer sur les réseaux sociaux", indique Satoko Inaba. "On les prévient aussi qu'ils doivent faire attention sur leurs réseaux sociaux privés - qu'il ne doit pas y avoir de lien avec la maison d'édition."

Lors des vagues de harcèlement, l'impact psychologique est toujours très difficile à encaisser - même si les community managers ne sont pas responsables des éventuels défauts des éditions publiées: "Au bout d'un moment, on en vient à être dégoûté par sa passion", déplore un ancien chargé de communication d'une maison d'édition. "On ne vit plus du tout de la même manière notre passion".
"Une démarche quasi terroriste"
Obtenir justice reste impossible, déplore un autre chargé de communication: "La boîte a engagé une procédure pour me protéger mais ses effets sont limités parce que la législation actuelle ne protège pas suffisamment du harcèlement sur les réseaux sociaux. Twitter, par exemple, ne divulgue pas l'identité de la personne. Et tant qu'on n'aura pas les outils pour combattre l'anonymat sur les réseaux sociaux, ce sera la jungle."
Si Matthieu Pinon reconnaît qu'il y a "des trucs imputables aux éditeurs" car "c'est un travail humain", rien ne peut justifier pareil déchaînement de violence. "C'est une démarche quasi terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes." Certains éditeurs ont pris la décision de ne plus mentionner certaines licences sur les réseaux. Pika ne parle ainsi plus de Rokudenashi Blues sur X (mais sur Instagram et Facebook).
Glénat aussi "fait attention", précise Satoko Inaba. Mais hors de question pour autant de fermer les réseaux sociaux du premier acteur du marché manga: "Comme on peut toujours améliorer beaucoup de choses, on reste à l'écoute. Même s'il y a des insultes et des bad buzz, on ne rompt pas tout contact. On comprend qu'ils font ça parce qu'ils sont passionnés. Nous aussi, on veut la meilleure version possible."
"Ces cas vont s'accentuer"
Arrivera-t-on à endiguer ces vagues de haine et de harcèlement? "Même si on fait de la pédagogie, certains ne font pas l'effort de nous comprendre", regrette un CM. "Ces cas vont s'accentuer. On est dans l’escalade avec les réseaux sociaux", abonde Matthieu Pinon. Certains appellent à une mobilisation des éditeurs et des lecteurs pour préserver un médium souvent méprisé:
"Il faut éviter que cette minorité représente notre communauté. Il faut protéger notre passion et les acteurs de notre passion même si on n'est pas toujours d'accord avec eux", martèle un ancien chargé de communication d'un éditeur de mangas. "Je ne veux pas qu'on définisse dans quelques années notre communauté comme une communauté qui peut être malveillante et dangereuse."
"Les personnes qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux peuvent être suivies un temps mais très vite d'autres personnes viennent les calmer", tempère Satoko Inaba. "Il y a un pouvoir d'autorégulation des réseaux sociaux." "Certains internautes très virulents dans leurs messages changent parfois de comportement et s'adoucissent dès qu'on leur répond", note également le CM d'un grand groupe.
Matthieu Pinon lance un défi à cette frange toxique de la communauté manga: "Certains, parce que le marché ne leur convenait pas, ont pris leur courage à deux mains pour créer des maisons d'édition. Ahmed Agne a fondé Ki-oon et Karim Talbi a monté Isan. Puisqu'ils se disent plus malins que les autres éditeurs, qu'ils se lancent! Ils se plaignent et harcèlent mais on ne voit pas un seul petit fanzine paraître."















