Un livre retrace l'histoire de "Charlie Hebdo", "un double combat pour les libertés et contre les cons"
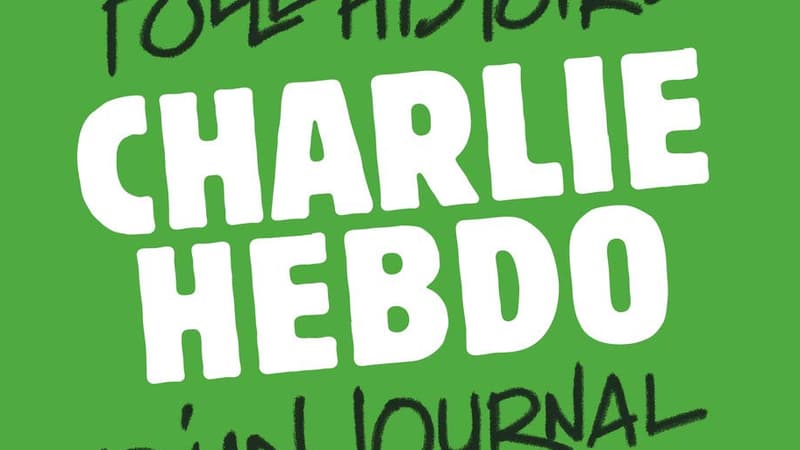
Détail de la couverture du livre de Christian Delporte sur "Charlie Hebdo" - Flammarion
Raconter l'histoire de Charlie Hebdo, c'est retracer un demi-siècle de luttes contre la censure. C'est aussi mettre en scène l'éclosion de certains des plus grands dessinateurs de la seconde moitié du XXème siècle et du début du XXIème. C'est ce récit que propose l’historien Christian Delporte dans Charlie Hebdo, la folle histoire d’un journal pas comme les autres (Flammarion), disponible en librairies à partir de ce mercredi 4 novembre.
Ce livre, dont la couverture verte rappelle immanquablement celle du numéro des survivants, paru le 14 janvier 2015, une semaine après les attentats, vise dans le brouhaha actuel à rétablir la vérité historique autour de la création de Charlie Hebdo. Christian Delporte rappelle le caractère unique au monde de l'hebdomadaire satirique, qui n'a "pas de ligne éditoriale, mais des valeurs", édictées par François Cavanna. Le dessin est au centre de Charlie. Ses journalistes en ont exploré toutes les possibilités pour raconter l’actualité. C'est aussi par le dessin que Charlie Hebdo est mort, puis s'est relevé. Il est le témoin de l'histoire "folle" de ce "journal pas comme les autres":
"Les journaux qui meurent et qui renaissent, c’est extrêmement rare. On a un journal qui a d'abord eu onze ans d’existence [de 1970 à 1981] avant de renaître en 1992. Il renaît avec les mêmes principes, mais adaptés à l’actualité du temps. Cette folle histoire, c’est la folle histoire de l’indépendance. Mais aussi la folle histoire de la tragédie, en 2015."
"L’humour, c’est un coup de poing dans la gueule"
Charlie Hebdo, c'est 50 ans d’attaques contre la liberté d’expression. Mais est-ce les dessins de ses journalistes ou leurs écrits qui dérangent? "Charlie, c'est un journal d’hommes et de femmes libres. Des hommes et des femmes qui ont une certaine idée de ce que doit être la presse, qui font un journal qui les font rire, eux. Ils pensent que si ça les fait rire, ça fera rire les lecteurs. Charlie a toujours appuyé là où ça fait mal", explique Christian Delporte avant de citer Cavanna: "L’humour, c’est un coup de poing dans la gueule."
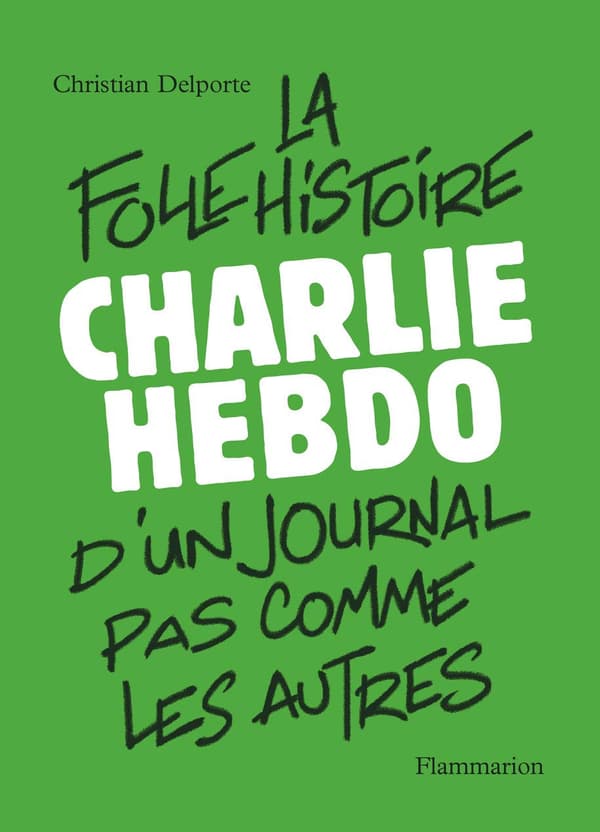
En caricature, rappelle ce spécialiste de la presse, "le dessin mièvre, qui fait plaisir à tout le monde, est un mauvais dessin": "Le propre de Charlie Hebdo, c’est de faire des dessins dérangeants", insiste-t-il. "La plupart des procès [intentés à Charlie] concerne non pas des textes, mais des dessins. Pourquoi? Parce que le dessin, c’est de l’émotion. Ça frappe tout de suite: ça fait rire, ça indigne. C’est ce qui fait la force du dessin de Charlie. Il est fait pour ça. Il est fait pour frapper. Il est fait pour éveiller quelque chose chez le lecteur qui incite au débat".
Avant de fonder Charlie Hebdo, Cavanna anime dans les années 1960 Hara-Kiri, journal bête et méchant. La France de ces années-là, celle du général de Gaulle, est assez rigoriste, mais voit apparaître une génération de dessinateurs de génie. Alors que Moebius, Bretécher ou encore Gotlib déploient leurs talents dans Pilote, puis Métal Hurlant, Fluide Glacial et L’Echo des Savanes, Hara-Kiri puis Charlie Hebdo deviennent la pépinière où Reiser, Wolinski et Cabu se révèlent à eux-mêmes sous le regard avisé de Cavanna.
"Cavanna, c’est un type formidable… un découvreur de talents", s'enthousiasme Christian Delporte. "Non seulement il sait attirer à lui des dessinateurs, mais il sait leur révéler ce qu’ils ne savent pas sur eux-mêmes. Si Reiser est devenu Reiser, c’est parce que Cavanna l’a aiguillé. Idem pour Wolinski. Ils avaient un bon coup de crayon, un certain esprit, mais ils n’avaient pas encore le style libéré qu’ils ont eu ensuite et qui a fait leur réputation." Dans les années 1990 et 2000, ce rôle de grand frère sera tenu par Cabu.
"Un double combat pour les libertés et contre les cons"
Délestés des tics de la ligne claire de l'époque, Wolinski et Cabu choquent par leur style graphique si simple qu'il en devient brutal en raison des sujets abordés: "Ce qui se dessinait dans le Charlie des années 1970 n’aurait pu se dessiner nulle part ailleurs, y compris dans des journaux très libres comme Le Canard enchaîné. Ils sont transgressifs. Ils ne respectent pas de règle. Ils pensent que l’humour n’a pas de règle", analyse Christian Delporte, avant de compléter:
"Wolinski, Reiser, Cabu rejettent non pas le dessin politique, mais le dessin politique tel qu’on le fait à l’époque, l’humour à la papa que l’on peut avoir dans le Journal du Dimanche - des couillonnades. Ils rejettent également le dessin parlermentaire, le commentaire quotidien de l’actualité parlementaire. Ils font des dessins de société, ils portent leur regard sur les dysfonctionnements de la société, pas sur le quotidien des politiques. C’est très nouveau à l'époque."
Charlie Hebdo s'inscrit dans une tradition française, qui remonte au XIXe siècle, du temps où Honoré Daumier était condamné pour s'être moqué en dessin du roi Louis Philippe. "Cette moquerie [en dessin] est extrêmement redoutable", commente Christian Delporte. "C’est très difficile de répondre. C’est plus facile de répondre à un texte par un texte, mais que répondre à un dessin? à un dessin qui cultive l’émotion et vous désarçonne complètement?" Charlie Hebdo a, depuis, pris le relais. Sa rédaction mène désormais "un double combat pour les libertés et contre les cons":
"Il y a de multiples cons. Ce n’est pas forcément les hommes au pouvoir. Ça peut être les gens qui ne comprennent pas, ceux qui sortent des brèves de comptoir. Ça peut être les chasseurs. Aujourd’hui, on est focalisé sur la question de l’islam, et on ne voit Charlie qu’à travers ce prisme-là, mais c’est bien plus large. On a par exemple oublié que le journalisme écologique est né dans Charlie."
En réalité, Charlie Hebdo s'adapte sans cesse à son époque. Au début de son histoire, dans les années 1970, le journal représente dans ses pages de manière frontale le sexe. "Dans les années 1970, parler du sexe est tabou", rappelle l'historien. "Comme c’est tabou, Charlie va en parler régulièrement et crûment. Aujourd’hui, il y a relativement peu de sexe dans Charlie, parce que ce n’est plus tabou. Charlie s’attaque aux citadelles. Le combat a changé. En 1970, l’état censurait la société qui aspirait à la liberté. Aujourd’hui, c’est le contraire, la société fait pression pour censurer les libertés que l’état protège. C’est pourquoi Charlie a changé. Autour de la question de la censure, qui a toujours été son combat, le contexte a été transformé."
"Un journal qui se sent un petit peu seul"
En cinquante ans, Charlie Hebdo a-t-il fait évoluer la liberté d’expression? "D’une certaine manière oui, avec les procès", estime Christian Delporte. "Grâce aux procès, il y a eu des jurisprudences, qui ont fait que les dessins sont protégés, que l’humour est protégé. De ce point de vue-là, oui, Charlie a fait évoluer la liberté d’expression. Sinon, ça ne reste qu’un journal. Mais en revanche lui n’a jamais renoncé à sa liberté. On peut tout dessiner chez Charlie. Il est le seul à faire ça. C’est bien son problème: aujourd’hui, c’est un journal qui se sent un petit peu seul."
Charlie a pourtant une descendance et il y a une véritable école Charlie. Luz et Catherine Meurisse sont désormais considérés parmi les auteurs les plus talentueux du 9e Art. Le premier grâce à des titres comme Catharsis ou Ô vous, frères humains et la deuxième grâce à La Légèreté et aux Grands espaces. Leurs albums de BD témoignent d'un style graphique très impressionnant, d'une grande liberté, et d'un humour féroce.
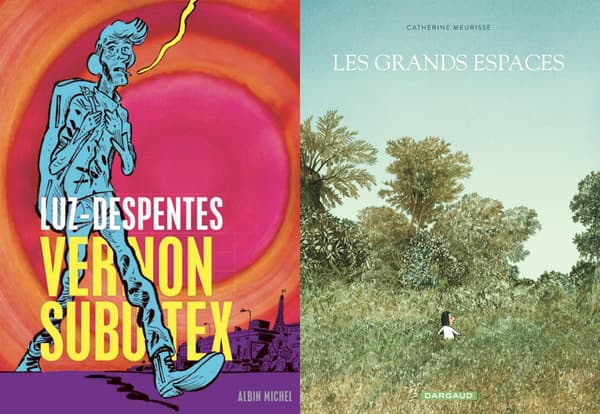
"Une fois qu’on est chez Charlie, on apprend à sortir de tous les académismes", note Christian Delporte. "Luz a transformé son dessin chez Charlie. Il y a eu les conseils de Cabu, mais les dessinateurs dessinent aussi ensemble. Ils apprennent ensemble. Ils se donnent des conseils. Ça n’existe dans aucune autre rédaction." Le prochain album de Luz, une adaptation de Vernon Subutex de Virginie Despentes à paraître le 12 novembre, où le dessinateur livre une invention graphique par page, le prouve. Et montre que l'esprit Charlie est bien présent dans la société.















