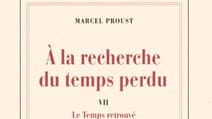Jean-François Monier
Cent ans de la mort de Marcel Proust: pourquoi son œuvre effraie-t-elle tant les lecteurs?
Le
Interminable et illisible ou au contraire indispensable et salvatrice, l'œuvre de Marcel Proust suscite toujours une avalanche d'adjectifs et de réactions tranchées, voire épidermiques. Alors que la Bibliothèque nationale anime à partir de ce mardi, avec un parcours dédié à "la fabrique de l'œuvre" proustienne, le bal des hommages à l'occasion du centenaire de sa mort le 18 novembre 1922, BFMTV.com s'est tourné vers d'éminents "proustiens" pour comprendre cette maldonne.
A la recherche du temps perdu raconte, en sept tomes et 3000 pages, l'apprentissage de la vie, de l'amour, des mécanismes de la mémoire et donc de sa vocation d'écrivain par un dilettante parisien, tandis que la société se déchire, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à la Première guerre mondiale.
Mais ce texte-fleuve à la réputation ambivalente, tantôt sommet de la littérature française et tantôt imbitable pavé au style ampoulé, fait peur. A tel point que sa lecture passe pour une épreuve - au mieux un exploit, au pire, un inutile masochisme.
"Difficile, labyrinthique"
Pourquoi l'œuvre de Proust est-elle devenue le symbole d'une littérature inaccessible? Le mérite-t-elle? Ou renfermerait-elle des trésors cachés expliquant la fascination qu'elle exerce? Mais alors comment les approcher? Qu'on s'en détourne, qu'on la respecte de loin ou qu'on la dévore, une chose est sûre, l'œuvre impressionne. Et l'aspect monumental du corpus est la première explication de cette frayeur du public. C'est ce que nous révèle Nicolas Ragonneau, fondateur du blog Proustonomics: "Je pense que Proust fait partie d’une construction: celle de l’écrivain national". "Construction" qu'il définit même comme une "espèce de mausolée".
Et le mausolée serait piégé: l'audacieux s'y aventurant aurait toutes les chances de se perdre dans ses phrases longues comme des tunnels. "La difficulté du style tient moins à la longueur de la phrase en soi qu’à la répétition des phrases longues", précise Nicolas Ragonneau qui concède:
"L’œil a parfois du mal à embrasser une phrase qui fait une page entière".
La balade s'annonce donc chronophage. Le réalisateur Thierry Thomas, qui a traduit son amour de l'écrivain dans son documentaire Proust, du côté des lecteurs, le reconnaît en préambule: "C’est une œuvre difficile à lire déjà parce qu’elle exige du temps." D'autant qu'on est d'emblée cueilli à froid. "Le début est extraordinaire mais difficile, labyrinthique", reprend le cinéaste. "Si on survit à ce début, on est armé pour toute La Recherche", promet cependant le fondateur de Proustonomics.
De surcroît, le récit convoque marquis, duchesses, valets, diplomates... Toute une (haute) société caractéristique du tournant du XIXe et du XXe siècle - avec sa toile de fond historique - bien éloignée de notre époque. Un élitisme qui trierait ses lecteurs sur le volet, engendrant presque sa propre aristocratie aujourd'hui. "Si on n’a pas l’arrière-plan historique, on aura du mal à comprendre", commence Alice Jacquelin, docteur en littérature générale et comparée et autrice de l'anthologie Osez (re)lire Proust, avant de déplorer: "La lecture de La Recherche, on en fait une performance sociale, ça devient un signe distinctif".
À la recherche des lecteurs
La performance ne doit toutefois pas être insurmontable puisqu'ils sont quelques-uns, malgré tout, à avoir lu tout ou partie de cette somme. Nicolas Ragonneau tente un portrait-robot: "Ce qui relie les lecteurs de Proust entre eux, c’est cette relation quasi-hypnotique au texte."
C'est d'ailleurs cette volonté de mieux connaître ces drôles d'oiseaux et d'en dénicher le point commun qui a animé Thierry Thomas au moment de pondre son Proust, du côté des lecteurs. S'il n'est pas sûr d'avoir trouvé sa réponse, il accepte de revenir sur sa propre découverte d'À la recherche du temps perdu. Il avait alors "14 ou 15 ans", et déjà "fou de cinéma et de Visconti", il avait appris que celui-ci en préparait l'adaptation:
"Et je n’étais pas bon élève, je n’avais pas un bon rapport à la scolarité. Je sentais que c’était une lecture qui pouvait être importante pour moi mais je ne voulais pas que ce soit un prof qui me l’enseigne".
Cette expérience initiale n'est pas toujours aussi punk. Alice Jacquelin a rencontré le texte en classe prépa et rend hommage à sa prof de lettres: "Je pense qu’il faut être accompagné pour le lire." Nicolas Ragonneau a, lui aussi, croisé la bête pendant ses études supérieures, mais un peu plus tard encore: "Quand j’ai fait la lecture de Du Côté de chez Swann, en 1991, c’était une lecture obligatoire pour l’agrégation. Je l’avais repoussée pendant des années, un peu par orgueil". "Et ça a été un vrai coup de foudre", nous confie-t-il.

La meilleure façon de lire Proust est encore la vôtre
On peut donc emprunter plus d'un chemin, scolaire ou non, vers La Recherche. On peut même couper à travers champs. "J’ai lu La Recherche dans l’ordre comme dans le désordre. On le lit comme on veut, enfin, surtout, comme on peut", témoigne ainsi Alice Jacquelin. "La Recherche n’est pas un bloc, les romans ont été découpés, redécoupés différemment au gré des éditions. On peut même en prendre des extraits. Il n’y a pas de sacrilège à piocher", plaide celle dont le dernier livre en exalte les morceaux choisis.
Thierry Thomas est cette fois à l'unisson. "Je n’ai pas commencé par le début. J’ai commencé par l’arrivée à Balbec, même pas par le début de À l’ombre des jeunes filles en fleurs!" s'amuse-t-il. Nicolas Ragonneau se dit lui-même "ouvert" à ces "hasards et accidents de lecture" mais fait valoir: "Malgré tout, Proust voulait un continuum. Donc, commencer par le début et terminer par la fin, c’est quand même mieux".
Ce récit sur le temps perdu et l'expérience du lecteur se rapprochent en tout cas à plus d'un titre. Car si l'œuvre est longue, ce dernier lui imprime son tempo. Pris par l'écriture, certains préfèreront se lancer dans un sprint, comme l'adolescent Thierry Thomas qui n'a "lu que ça pendant cinq ou six mois". D'autres vont privilégier la course de fond. Seconde école à laquelle appartient Nicolas Ragonneau qui après avoir bachotté Du Côté de chez Swann, le premier volume, pour son agrégation, a décidé de faire durer le plaisir en se bornant à lire un tome par an. Rythme dont il met en évidence les vertus:
"Tout à coup, devant ce texte sur le temps et les métamorphoses, vous devenez vous-mêmes quelqu’un d’autre. Comme le récit dure des années, les personnages changent, et en lisant pendant des années, vous aussi vous changez!"
"Quand j’ai commencé la lecture j’étais jeune homme, quand je l’ai terminée j’étais sur le point de devenir père de famille; quand j’ai commencé j’étais étudiant et à la fin, je travaillais".
Peu importe la discipline qu'il s'est imposé, le proustien en ressort à bout de souffle. Mais il n'en a pas fini avec l'œuvre. Il y reviendra. Thierry Thomas, qui l'a relue plusieurs fois intégralement, prolonge ainsi: "Il m’arrive de passer six mois sans la lire. Mais il y a des moments difficiles dans la vie où j’y reviens toujours – car Proust vous accompagne comme un ami". "Et quand je revois ce que j’ai noté dans le livre ado, ça me fait très bizarre. C’est vertigineux", se trouble-t-il.
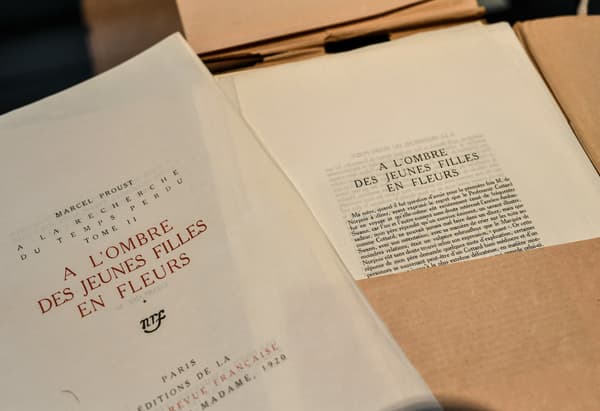
Une écriture qui sidère
On commence à le comprendre: Proust fiche le vertige. Mais qu'y a-t-il de si grand chez lui pour qu'il vole apparemment si haut? L'écriture bien sûr, dont Thierry Thomas compare "le style sidérant" à une "symphonie très complexe": "On n’entre pas dans ses arcanes mais quelque chose vous touche. On est surpris d’abord, puis on progresse, et la respiration du texte devient la vôtre, et vous absorbe". Alice Jacquelin aussi se souvient d'avoir été prise dans des rouleaux: "Il écrit comme un classique, avec une grande prosodie, un rythme, une acmé, puis une redescente. C’est comme une houle qui monte, puis un ressac".
Stéphane Varupenne, qui a interprété le narrateur lorsque la Comédie française dont il est sociétaire a adapté Le Côte de Guermantes, et a participé aux lectures de l'œuvre par la troupe, a même craint la noyade. "Dans les lectures qu’on a faites, il y a des moments où si on avait une demi-seconde d’inattention, on avait l’impression de se noyer, en se disant : ‘Mais j’en suis où, ça parle de quoi ?’", nous livre-t-il. En prêtant sa voix au texte sur scène, l'acteur en a appris beaucoup sur ce que celle de l'auteur avait de singulier:
"Dans le spectacle de Christophe Honoré, on a vu qu’il était difficile de rendre les moments de description. Il fallait à la fois rendre les choses concrètes pour accrocher le spectateur et en même temps rendre la musique, la poésie du texte".
Pour parvenir à rendre cette "fragilité, cette sensibilité", il a alors "essayé de trouver un endroit de parole très ténu".
"Oubliez tout ce que vous croyez savoir"
Reste à trouver la manière d'établir une telle connexion avec La Recherche. Afin de s'éviter toute inhibition, il est d'abord permis de désacraliser le monument. "Il y a un peu des redites, on a compris sa façon de fonctionner, sa jalousie, donc au bout d’un moment il y a des longueurs", n'hésite pas à glisser Stéphane Varupenne au sujet d'Albertine disparue, sixième épisode de la saga. La critique n'a rien du blasphème si on en revient à l'origine de l'œuvre, note Alice Jacquelin: "Proust a été édité en romans successifs, ce n’était pas La Recherche. Les gens prenaient les romans un par un et disaient ‘celui-ci est bon, celui-ci est moins bon’".
Encore faut-il savoir dans quoi on met les pieds. "Il y a une dimension analytique très importante chez Proust", relance l'universitaire: "On peut être décontenancé si on l’ouvre en se disant qu’on va lire un roman. Ce qu’on attend d’un roman – l’intrigue, les péripéties – y est, mais très délayé". De toutes façons, le maître-mot peut se résumer comme suit: "Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur La Recherche". Précieux, Proust?
"C’est quand même un texte qui comporte une scène d’onanisme dans ses premières pages, qui a des scènes lesbiennes, des scènes sado-maso, des commentaires comme celui de Jupien sur le ‘gros pétard’ de Charlus", balaie Nicolas Ragonneau.
Sans compter qu'on n'est pas l'abri de rire à la lecture, de la repartie bien sentie à l'humour des plus potaches. "Il y a tous types de comiques dans La Recherche. Il ne faut pas oublier que Proust était le contemporain de Chaplin, de Keaton", souligne l'auteur de Proustonomics.
Enfin, au risque de prêcher pour sa paroisse, l'autrice de l'anthologie Osez (re)lire Proust, suggère une dernière piste: "La façon la plus abordable d’entrer dans le livre est plutôt de passer par des extraits."
Le moment Proust
Chargé de tous ces conseils, il serait tentant de se précipiter pour rattraper le temps perdu. Mais peut-être est-il plus sage de faire encore un peu mariner la madeleine dans la tasse de thé. Thierry Thomas est plutôt d'avis de foncer: "Je pense qu’il faut mieux le lire tôt." "Comment voulez-vous consacrer du temps à cette lecture quand vous êtes aliéné par votre travail?" justifie-t-il.
Mais il existe pourtant des livres qui viennent mieux avec l'âge. C'est pourquoi ils sont nombreux à proposer de laisser ce chef-d'oeuvre vieillir en fût. "Je pense qu’il faut avoir vécu des choses pour pouvoir s’identifier et comprendre certaines finesses de comportement, de relation. Si je l’avais lu trop jeune des choses me seraient passées complétement au-dessus", plaide le comédien. "Proust ça ne peut pas venir avant le grand amour, avant la rupture de l’adolescence, la désillusion vis-à-vis des parents", tranche Alice Jacquelin.
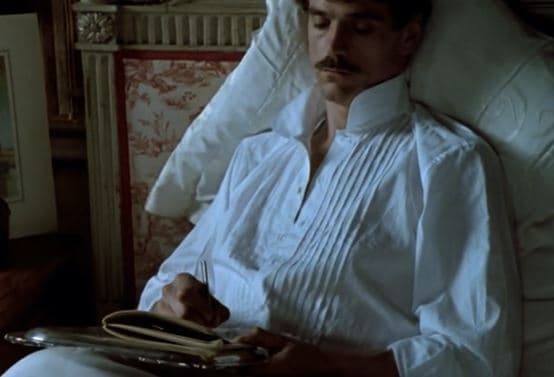
Les promesses d'un livre "sans prix"
Le jeu en vaut la chandelle. Une lecture de La Recherche opérée dans de bonnes conditions, en temps et en heure, ne ménage pas ses cadeaux. "Ce à quoi on peut s’attendre en lisant La Recherche, c’est à être surpris, et Proust est très fort pour les surprises!" confirme d'office Nicolas Ragonneau.
Il s'agit aussi de mieux se connaître. "On est lecteur de soi-même", appuie en effet Nicolas Ragonneau. Stéphane Varupenne affirme même avoir eu l'impression de "faire sa psychanalyse". "Il y a des choses que j’ai comprises de ma vie ou de mes rencontres, certains comportements, certaines attitudes", explique-t-il. Thérapie de choc littéraire "au cœur de l'expérience proustienne" selon Alice Jacquelin: "On ressasse, on revient sur nos expériences, traumatisantes ou non, ses sensations."
Mais c'est sans doute le documentariste de Proust, du côté des lecteurs qui est le plus susceptible d'avoir les mots pour leur parler. Pour lui, l'essentiel est affaire de sentiment: "Je dirais que ce qu’on découvre c’est que quand on est envahi par la joie dans la vie, il faut être attentif à cette joie et comprendre que c’est là qu’on doit être, et ne pas l’oublier". Il achève: "Un livre qui nous permet de le comprendre est sans prix".