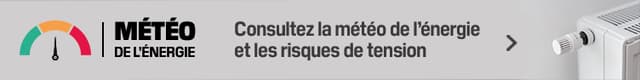Après la crise de cet hiver, comment va évoluer le marché européen de l'électricité?
L'hiver 2022-2023 achevé, RTE tire des enseignements de cette période particulière pour le marché européen de l'électricité. Depuis un an, le système européen qui est un mélange de marchés et d'interconnexions a fait face à une situation de tension inédite qui s'est manifestée sur trois terrains: une crise de la disponibilité du gaz, une crise de la production nucléaire et une sécheresse hydraulique. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité met en avant un système qui a assuré la sécurité d'approvisionnement, puisque les échanges entre pays n'ont subi aucune restriction et les flux d'électricité ont été réorientés immédiatement vers les pays qui en avaient le plus besoin.
"Le degré d’harmonisation entre les pays européens est supérieur à celui entre les Etats américains sur le système électrique", souligne Thomas Veyrenc, directeur exécutif en charge du pôle Stratégie, prospective et Evaluation de RTE.
Cependant, le gestionnaire adopte une deuxième lecture sur ces derniers mois dont il a résulté une envolée des prix, notamment en France sur les marchés à terme de l'électricité avec des conséquences économiques importantes certes atténuées par les dispositifs de protection existant (ARENH, Tarif réglementé de vente) ou définis à cet effet comme le bouclier tarifaire ou encore l'amortisseur.
Compléter les marchés de court terme par des mécanismes de long terme
S'il salue donc l'efficacité du système européen pour assurer la sécurité d'approvisionnement, RTE pointe du doigt un manque de signaux économiques à long terme et une absence de cohérence à deux égards de la dépendance des prix de l'électricité pour le consommateur de ceux énergies fossiles. Cette dépendance n'est pas cohérente d'une part avec la politique climatique qui nécessite d'électrifier rapidement pour sortir de ces énergies fossiles et d'autre part avec la politique qui vise à réindustrialiser alors que d'autres parties du monde bénéficient d'énergie à bas prix et de mesures protectionnistes.
Le gestionnaire estime ainsi que le marché européen électrique doit reposer sur deux piliers. Il faut d'abord préserver le bon fonctionnement des marchés de court terme qui a prouvé sa robustesse en situation de crise et permet une optimisation efficace des ressources. Puis, il faut compléter ces marchés de court terme par des mécanismes de long terme afin que les prix effectivement acquittés par le consommateur final reflètent les fondamentaux économiques de la production d'électricité français et le choix d'un mix électrique très largement décarboné.
"Le consommateur paye un prix qui n’a très souvent rien à voir avec celui des marchés spot ou à terme, insiste Thomas Veyrenc. Quand on regarde les questions de prix de l’électricité, c’est bien celui que paye le consommateur qu’il faut regarder."
RTE rappelle ainsi que depuis un quart de siècle, les systèmes électriques nationaux ont été libéralisés et intégrés au sein du marché unique de l'énergie dont les objectifs sont d'assurer une sécurité d'approvisionnement à un prix abordable à tous les consommateurs, le tout dans le respect des objectifs climatiques et de la promotion d'une concurrence saine sur le marché européen.
Un effet de décalage entre les prix sur les marchés et leurs répercussions sur les consommateurs
Pour analyser l'évolution des prix de l'électricité sur l'année 2022, le gestionnaire distingue l'évolution des prix spots et celle des prix à terme. Les premiers ont reflété les fondamentaux de l'équilibre offre-demande du système européen en traduisant les évolutions des prix des combustibles, la disponibilité des moyens de production et le niveau de demande. La faible production nucléaire et hydraulique a fait qu'ils ont atteint des niveaux records en France au cours de l'été (612 euros le MWh en moyenne sur la semaine du 22 août) avant de retrouver des niveaux plus faibles à la rentrée tout en restant élevés pour finalement décroître significativement entre mi-décembre et mi-janvier.
En ce qui concerne la hausse des prix de l'électricité à terme, celle-ci a en réalité commencé avant même l'invasion de l'Ukraine pour atteindre son paroxysme à l'été 2022. Dès la fin de l'année 2021, elle a été la conséquence de la reprise économique mondiale post-Covid conjuguée à un faible remplissage des stocks de gaz dans certains pays européens. La crise géopolitique entre l'Europe et la Russie est ensuite survenue puis des craintes sur la sécurité d'approvisionnement en France ont émergé chez les acteurs du marché et été largement alimentées par les effets perceptibles de la faible disponibilité du nucléaire français.
Contrairement aux prix spots, les prix à terme enregistrés en France à l'été 2022 pour une livraison à l'hiver suivant se sont écartés des fondamentaux et été supérieurs à ceux des pays voisins comme l'Allemagne, ce qui s’explique par l’existence d’une prime de risque pour la France. "La détente sur les prix de l’électricité constitue une perspective positive pour les consommateurs qui demeurent exposés aux prix de marchés, en particulier pour les entreprises, ajoute RTE. Cette baisse ne se traduit pas immédiatement par une baisse des factures d’électricité pour tous les consommateurs, notamment dans la mesure où les contrats de fourniture sont basés sur les marchés à terme, plusieurs mois à l’avance."
"Les répercussions de la crise sur les marchés en 2022 seront sur la période 2023-2024", indique Thomas Veyrenc.
Les objectifs français repris dans la proposition européenne de réforme
Au niveau européen, la réforme du marché électricité européen actuellement discutée est de nature structurelle et vise à faire converger les prix à court terme et les coûts du système. La proposition législative publiée il y a près d'un mois par la Commission européenne après une consultation publique d'un mois fait suite aux mesures d'urgence mises en place en 2022 qui sont applicables depuis le 1er décembre dernier et ce jusqu'au 30 juin prochain pour l'instant. Pour les Etats membres, il s'agit de plafonner les revenus des producteurs d'électricité à 180 euros le MWh. L'Espagne et le Portugal constituent des exceptions puisque ces deux pays plafonnent le prix du gaz pour la production d'électricité.
Selon RTE, cette proposition de l'exécutif européen reprend les objectifs défendus par les autorités françaises. Parmi ces objectifs majeurs figurent la préservation du fonctionnement du marché de court terme avec une allocation optimale des moyens de production et des flux à la maille européenne, un investissement encouragé dans les acteurs de production décarbonés et la possibilité pour les consommateurs français de bénéficier de l'avantage compétitif d'un mix déjà largement décarboné et aux coûts de fonctionnement faibles. Sur ce dernier point, le gestionnaire évoque une "nécessité particulièrement marquée en France où 93% de la production est bas carbone (situation nominale) alors que, 90% du temps, les prix de marchés dépendent directement ou indirectement d’une centrale utilisant une énergie fossile".
"2026 est dans très peu de temps et il y a aujourd’hui urgence à définir le cadre dans lequel se feront les achats d’électricité en 2026", insiste Thomas Veyrenc.
Le calendrier d'adoption de la réforme fait néanmoins lui-même débat alors que le conseil des ministres de l'énergie du 19 juin est ciblé en vue d'un accord. De son côté, la France souhaite une adoption du texte avant la fin de l'année et que ce calendrier s'articule avec la réforme du dispositif de l'ARENH (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique) qui s'achèvera en 2025.