Le berger australien, chien préféré des Français: ce que cette mode canine dit de nous

Trois bergers australiens. - JoDi via Wikimedia Creative Commons
De tous les âges, de tous les gabarits et de toutes les couleurs. Il faudrait presque fermer les yeux pour ne pas les voir trottiner dans les rues de nos villes. Ce qui ce serait dommage d'ailleurs tant un coup d'œil peut suffire à comprendre la popularité actuelle des bergers australiens.
L'espèce, concoctée vers 1900 par des fermiers basques qui l'ont emmenée avec eux en émigration en Australie avant de s'épanouir dans les ranchs américains, a obtenu sa consécration cette année. La Société centrale canine, qui contrôle l'authenticité des races et enregistre les spécimens qui lui sont soumis dans son Livre des Origines Français (LOF), en a fait très officiellement le "chien préféré" de nos compatriotes le 21 janvier dernier.
Une nouvelle consécration plutôt, car le règne de l'"Aussie" sur ce classement a débuté en 2018. En 2020, plus de 16.000 bergers australiens ont été inscrits au LOF, un bond de 14% par rapport à l'année précédente. C'est la première race à dépasser les 15.000 enregistrements annuels depuis le berger allemand en 1980.
Le chien d'Instagram?
"En principe, la mode change tous les ans pratiquement, mais cette fois ça dure", glisse Mathilde Beyer, chargée de dossier auprès du LOF, à BFMTV.com. "C'est une race très convoitée pour son physique, ses yeux vairons, ses robes de couleurs variées, qui sortent de l'ordinaire, comme le bleu merle."
Ce billet de blog du Monde complète le tableau: le mâle mesure de 50 à 60 centimètres, la femelle de 45 à 55 centimètres. Et le berger australien peut étirer son espérance de vie le long de 12 à 16 ans. Avec ça, on souligne universellement son activité physique mais aussi sa sociabilité et son intelligence. Un portrait bien sous tous rapports qui a un prix: de 900 à 1500 euros.
Visiblement, ce montant ne décourage pas les acheteurs. Mathilde Beyer note la diversité de ceux-ci mais relève tout de même une dominante: "De plus en plus de propriétaires âgés de 20 à 30 ans." Parfaitement coulée dans le moule de l'époque, la rencontre du chien à la belle gueule et de ce jeune public produit bien les étincelles qu'on pourrait en attendre sur le terrain numérique.
"C'est un chien très mignon donc instagrammable", pose Mathilde Beyer.
Victime de la mode
"C'est pas compliqué de faire une belle photo d'un berger australien qui tourne la tête vers vous, c'est un animal vif", tacle Raphaëlle Ruiz.
L'institutrice est la présidente du Club français des bergers australiens. Elle en a trois aujourd'hui, et a adopté son premier dès 1985, à une époque où la race n'était pas encore reconnue - elle ne l'est que depuis 1996 en France. Si depuis 35 ans, il n'est "plus question" pour elle de s'imaginer "avoir un autre type de chiens", Raphaëlle Ruiz refuse cependant de donner dans l'image d'Epinal ou dans l''"Insta". Et égratigne au passage ces nouveaux maîtres de bergers australiens, souvent primo-accédants à un chien:
"Beaucoup de gens les achètent alors qu'ils n'ont jamais eu de chien avant. On l'achète comme le nouvel enfant de la famille. Mais si le chien ne reçoit pas d'éducation ferme, et pendant une période de 18 à 24 mois, c'est une catastrophe ambulante! Ca donne un chien mal sociabilisé, donc destructeur et donc mordeur".
La présidente du Club français des bergers australiens souligne d'ailleurs que notre "chien préféré" est désormais le plus fréquemment abandonné, ou placé en rééducation. "Il peut avoir un foutu caractère, le berger est un chien de troupeau après tout", fait-elle valoir.
Trafic et surproduction pour répondre à une demande galopante, gestations opérées chez des femelles bien trop jeunes par des éleveurs à la morale douteuse... De mauvais démons s'agitent au-dessus de la création des fermiers basques. "Vivement qu'il ne soit plus à la mode!" n'hésite pas à s'exclamer Raphaëlle Ruiz.
Extension du domaine de la culture populaire
Si le berger australien n'est pas le premier canidé à faire l'objet d'une telle vogue, la fixation de l'opinion autour d'un chien est un phénomène historique qui s'est intensifié au cours des dernières décennies.
"Les modes canines sont une constante depuis 30 ou 40 ans", balise le sociologue Christophe Blanchard - également maître-chien depuis son service militaire. Au point que les sciences humaines s'en emparent, à travers une discipline récemment éclose, les Animal studies.
Pour qu'un chien connaisse une telle ascension, il lui faut d'abord percer médiatiquement à travers un film, une série, les fils des réseaux sociaux, ou son fidèle compagnonnage aux côtés d'une personnalité. Le Jack Russel, par exemple, a concentré ces facteurs pour cumuler non pas une mais trois heures de gloire, illustre Christophe Blanchard: "D'abord, après le film The Mask en 1994, puis The Artist en 2011 et enfin après les apparitions télés du chien de Christophe Dechavanne".
L'historien Eric Baratay, qui a récemment dirigé la rédaction de Croiser les sciences pour lire les animaux, attire notre attention en direction d'un autre support culturel déterminant au sortir de la guerre: "La lecture des bandes-dessinées se banalise. Le modèle, c'est Boule et Bill".
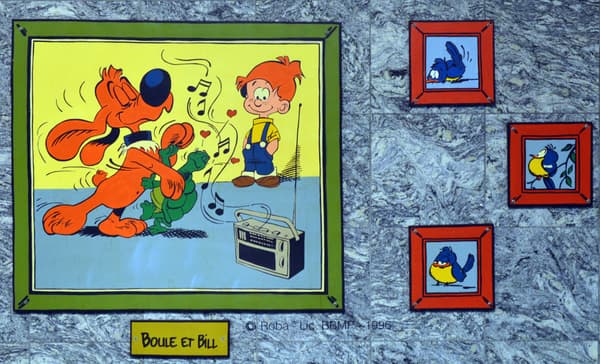
Avatar de la bourgeoisie
La promotion du chien dans cette imagerie populaire et quotidienne génère d'ailleurs un bénéfice indéniable. L'animal jouit dorénavant d'une considération bien supérieure. Longtemps tenu par le droit comme un simple bien meuble, il en est à présent un sujet. Le Parlement vient d'ailleurs de voter ce jeudi une nouvelle loi contre la maltraitance animale.
Mais la situation est très ambivalente. Christophe Blanchard note: "Si les modes canines obéissent à un effet de contagion classique, c'est parce que le chien est un objet de consommation courante".
Depuis la fin du XIXe siècle, "on assiste à une industrialisation du chien, avec l'élaboration des races et le business autour", pointe le sociologue. En 1881, on fonde la Société centrale canine. "Elle est structurée par une élite qui valorise les races", continue l'expert qui précise: "C'est la société bourgeoise qui norme nos références canines".
Depuis les derniers feux du Moyen-Âge et jusque là, le chien en tant qu'animal domestique est en effet surtout le compagnon de l'aristocratie. Ce modèle se diffuse alors "dans les autres classes sociales", pointe Eric Baratay. "On a cependant des attentes diverses autour du chien d'un milieu à l'autre. Longtemps, l'ouvrier, par exemple, à un rapport plus froid à son chien."
C'est très récemment que l'approche du chien s'uniformise. "Avec les Trente glorieuses, tout le monde se met à avoir un chien. Et l'extension des villes en fait aussi un phénomène de banlieue pavillonnaire qui fait qu'ensuite, même le monde paysan se met à avoir des chiens pour l'agrément", achève Eric Baratay.
"Une manière d'investir l'espace public"
Les enjeux sociaux ne sont pourtant pas éteints autour de l'animal. Car avoir un chien c'est aussi le promener et donc "une manière d'investir l'espace public", prolonge Christophe Blanchard.
"Le chien qualifie la classe sociale à laquelle on appartient. C'est un message symbolique relevant de rapports stéréotypés de classe. Par exemple, le lévrier italien du Parisien va s'opposer au molosse de banlieue", exemplifie l'essayiste.
Celui-ci se penche alors sur le versant plus personnel de la chose: "Mais si on veut montrer sa maîtrise de l'animalité, on ira plutôt vers le malinois que le chihuahua". "Un chien est un imaginaire fantasmé de qualités intrinsèques qu'on s'approprie par une sorte de transmutation. C'est de l'anthropologie: on imagine que l'objet, c'est nous".
Le prochain chien à la mode sera un chat
Manifestes sociaux en même temps qu'expressions individuelles, les modes canines se succèdent dans un ballet qu'on croirait inexorable. Ce n'est pas le cas. Et le présent dessine, déjà, le destin du chien. Un chien plus rare, moins visible car relégué socialement et amoindri numériquement. "Il y avait 12 millions de chiens en France dans les années 1980-1990, on est tombé à sept millions", chiffre Eric Baratay qui accuse "la dégradation de son image par des faits-divers".
De surcroît, les chiens sont victimes de la gentrification... et de leurs grands rivaux.
"Les chats remplacent les chiens dans les centres-villes", diagnostique l'historien: " À notre époque, on produit des races de chats dans tous les sens. En fait, ils vivent aujourd'hui ce que les chiens ont vécu il y a un siècle".
Le berger australien peut bien frétiller dans les rues, son successeur chartreux ou siamois le guette déjà, bien au chaud, du haut de sa fenêtre et de son serein mépris.















