Ramadan: Mahomet, une énigme pour les historiens
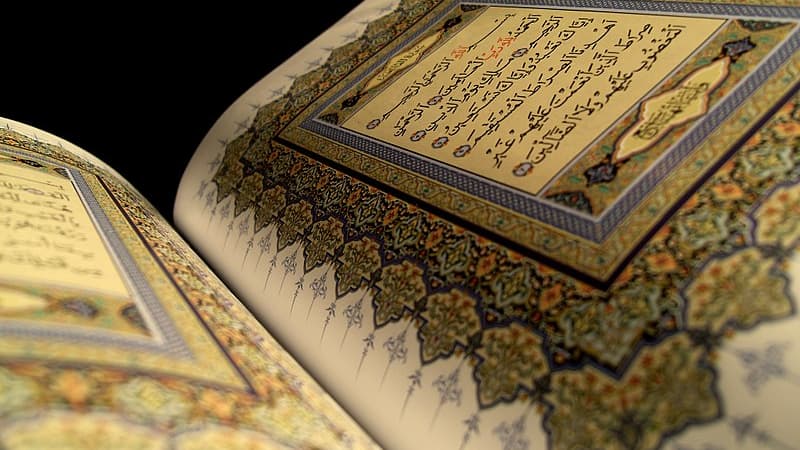
Le Coran. - Habib M’henni via Wikimedia Creative Commons.
La postérité s’est montrée particulièrement généreuse envers Mahomet, l’intronisant prophète, fondateur de religion, législateur, chef d’Etat et chef de guerre. Il a même intégré le cercle très restreint des personnages dont le souvenir survit depuis plus de 1500 ans à leur mort et semble destiné à une forme d’éternité.
La longévité de son nom, qui sous la forme de "Muhamad" accompagne les prières de deux milliards de musulmans dans le monde, est exceptionnelle. Elle a cependant sa contrepartie: la tradition s’est mêlée à la biographie, au point de remplacer purement et simplement le Mahomet de chair et d’os par un double statufié par la religion.
Car si l’existence historique de celui que l'islam appelle le "Sceau des prophètes" est une cause entendue, un autre consensus se dégage de la recherche moderne: le Mahomet canonique, dont on dit qu’orphelin mecquois recueilli par un de ses oncles il est devenu commerçant, voyageant jusqu’en Syrie, avant de recevoir les ultimes commandements divins via l’Ange Gabriel, est au mieux une énigme, et probablement un récit composé et réarrangé par les autorités islamiques quelques décennies après son dernier souffle.
La conquête et l'éclipse
Mort autour de l’année 632, à Médine, Mahomet a pourtant connu une éclipse au VIIe siècle alors même que la nouvelle foi, née en Arabie, s’élançait vers l’Orient, l’Asie et l’Afrique. Car des années 630 aux années 650, les Arabes s’embarquent dans un vaste cycle de conquêtes, arrachant la Palestine, la Syrie, et l’Egypte aux Byzantins et les actuels Irak et Iran aux Perses sassanides.
Une première guerre civile, ou fitna en arabe, déchire alors cet empire balbutiant mais en croissance rapide: on se partage entre Mu’awiya, parent d’Uthman, un calife assassiné, et Ali, gendre de Mahomet et père de ses seuls petits-fils. C’est finalement le premier qui l’emporte sur la revendication du second, qui incarne pourtant la famille du Prophète. C’est là le point de départ d’un éloignement qui dégénérera en fracture, entre les sunnites, et les chiites, reconnaissant l’autorité d’une lignée d’"imams" descendant de Mahomet via Ali.
On ne se préoccupe guère, semble-t-il, de Mahomet durant cette période. Pourtant, la seconde guerre civile, à la fin du VIIe siècle, le propulse sur une avant-scène qu’il ne quittera plus. Les Omeyyades au pouvoir font désormais face aux Zubayrides, famille tirant son nom d’un compagnon de Mahomet, dont l’un des membres s’est proclamé calife en Arabie. Les partisans de la famille d’Ali, quant à eux, sont toujours nombreux. Ces trois légitimités qui s’affrontent éprouvent un farouche et crucial besoin de se distinguer les unes des autres. Mahomet leur en fournit l’occasion. Antoine Borrut, professeur d'Histoire associé à l'Université du Maryland et qui a notamment dirigé la rédaction de Écriture de l'histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam détaille auprès de BFMTV.com:
"Dans un contexte de forte concurrence politique, les Zubayrides disent: ‘Nous sommes les plus légitimes car nous sommes les plus proches du Prophète'. La proximité généalogique avec le prophète devient centrale pour les Zubayrides, les Omeyyades mais aussi plus tard pour les Abbassides qui descendent de Haschim, arrière-grand père de Muhamad".
"Le calife debout"
Les Omeyyades brisent une nouvelle fois la concurrence et confirment leur califat. Et l’arme idéologique qu’était Mahomet devient une politique impériale à part entière. C'est alors que la monnaie devient l’un des supports de la publicité nouvelle dont jouit Mahomet, sous le calife Abd al-Malik, une personnalité hors norme. Gabriel Martinez-Gros, historien spécialiste de l’homme de lettres du XIVe siècle Ibn Khaldoun et auteur récemment de L’Empire islamique, le présente ainsi: "Abd al-Malik finit la guerre civile, il désarme l'Irak, institue une frappe monétaire islamique, fait de l'arabe la langue de l'empire. Al-Hajjaj, son grand ministre, adapte l'arabe à ses fonctions impériales".
"Les Omeyyades sont une dynastie expérimentale: ils essayent. Abd al-Malik impose la monnaie purement épigraphique certes mais entre 693 et 697, il fait frapper des pièces avec le motif dit du ‘Calife debout’", pose Antoine Borrut. L’œil non averti balaierait là rapidement l’image d’un homme dressé de toute sa hauteur, barbu, vêtu d’une cape et armé d’une épée, et n’y verrait probablement pas malice. Autour du personnage, une auréole de caractères serrés: la fameuse profession de foi. Ici, réside le mystère: "Muhamad est le seul individu nommé sur certaines de ces pièces et des numismates ont fait remarquer qu’il n’y a pas d’exemples connus de monnaies nommant un personnage mais en représentant un autre. La question qui en découle est de savoir si les Omeyyades ont ainsi brièvement représenté non pas le calife mais bien le Prophète sur leur monnaie", formule Antoine Borrut.
Pierre angulaire du califat
Une chose est sûre: c’est bien le nom de Mahomet qu’exalte le Dôme du Rocher, souvent considérée comme la première création artistique et architecturale proprement islamique. Plusieurs des inscriptions courant sur le monument, construit en 692 par Abd al-Malik, bénissent ainsi le dernier des prophètes des musulmans. Une promotion d’autant plus notable que le Coran lui-même, dont la version définitive est élaborée lors de ces mêmes années du crépuscule du VIIe siècle, ne mentionne que quatre fois le Médinois d’adoption. "Le Dôme du Rocher, c’est le moment de la bascule, celui où apparaissent les références au Prophète", développe Antoine Borrut.
Le défunt Mahomet, qui semblait si effacé dans les consciences depuis sa mort, se retrouve à présent sur au fronton de l’Etat en formation. Nos spécialistes ont quelques pistes pour expliquer ce mystérieux retour de flamme posthume.
"Il y a deux pistes de recherche", éclaircit pour nous Mohammed Ali Amir-Moezzi, l’un des auteurs du Coran des historiens. "Celle selon laquelle Abd al-Malik est le vrai fondateur de l’islam comme religion impériale. Car à partir de là, l’islam a sa culture, son livre, son législateur. Et Il fallait que l’empire ait son législateur". L’expert poursuit: "Il y avait le souci d’avoir une religion à soi, et vraiment arabe."
Mohammed Ali Amir-Moezzi expose la seconde piste: "L’autre piste, c’est qu’ainsi on neutralise l’importance d’Ali qui avait beaucoup de partisans." Gabriel Martinez-Gros explique en effet que l’enthousiasme autour d’Ali et sa descendance a poussé le pouvoir omeyyade, qui a fondé son pouvoir sur sa victoire contre ce dernier, à réagir en réévaluant la place de Mahomet dans le débat religieux: "Les califes omeyyades ont eu ce besoin probablement parce que le chiisme commençait à exalter Ali dans des proportions au-delà de ce que ses adversaires jugeaient raisonnable."
Mahomet récupéré
L’exploitation institutionnelle de Mahomet ne va cependant pas de soi. "Au fur et à mesure que l’État se constitue, il prend le Prophète comme ancêtre et la pratique du Prophète comme normative mais il y a quelque chose qui lui est particulièrement difficile à adapter, c'est le jihad", éclaire Gabriel Martinez-Gros. Mahomet d’ailleurs ne sortira pas indemne de son instrumentalisation politique, selon celui-ci: "Le jihad ne peut pas être au centre des préoccupations de l’État. Au centre de celles-ci, il y a l'impôt, l'ordre et donc une vie pacifique. L’État est une réalité profondément pacifiante. Il est gêné par une obligation du jihad qu'on déduit de la vie du Prophète. Donc la tendance de l’État est de vider la vie du Prophète de cette substance guerrière".
Surgit aussi, durant le Moyen âge, un usage presque anti-étatique du prophète. "Au contraire, tous ceux qui sont dans les marges et cherchent des recours contre le centre vont puiser dans la dimension guerrière de Muhamad en en faisant un révolté, le père de toutes les révoltes", ajoute Gabriel Martinez-Gros.
Vieille lune puis trophée de guerre, ensuite instrument au service de l’Etat, bannière populaire ou recours des minorités: on comprend aisément que Mahomet sorte pour le moins transformé de ces incursions politique. Au point sans doute d’avoir défiguré le personnage historique. Alors Mahomet méconnaissable à jamais?
Premières tentatives de biographie
Ça fait pourtant des siècles que les savants s’échinent à s’attacher aux pas d’un homme dont le désert et sa mer de sables ont depuis longtemps noyé les traces. Il faut dire que les pouvoirs politiques, là encore, ont veillé à l’établissement d’une biographie officielle, la Sîra. "Quand les Abbassides prennent les manettes (à partir de 750, NDLR), ils commanditent presque immédiatement la Sîra. On a longtemps dit que les Abbassides étaient les premiers à faire la biographie du Prophète mais c’est faux, il y a eu des efforts avant, comme ceux de Urwa ibn Zubayr, frère du calife vaincu qui passe aux Omeyyades après la défaite de son frère, et ceux d’al-Zuhri", intervient Antoine Borrut.
Mais avant même que théologiens et croyants n’écrivent la biographie de leur prophète, celui-ci transparaît dans les inquiétudes et les textes des contemporains de la naissance de l’islam.
"On peut commencer plus tôt que la Sîra avec des sources non-musulmanes et non-arabes, rédigées en grec, en syriaque etc., du VIIe siècle, dont certaines remontent aux années 630. Des thèmes communs s’en dégagent, et six éléments apparaissent largement: d’abord, on parle très souvent des ‘Arabes de Muhammad’, on dit que c’est un marchand, qu’il initie les conquêtes, que c’est un roi, qu’il prêche un renouveau du monothéisme, qu’il est législateur, enfin il est dépeint comme un faux prophète", liste le professeur associé de l’Université du Maryland. Et d’après le spécialiste, la recherche comparée pourrait, sur cette base, dégager les premières certitudes concernant Mahomet. Car ces sources des années 630 et les écrits musulmans décrivent Mahomet dans les mêmes termes… sauf évidemment que les seconds ne font pas de ce dernier un "faux prophète".
En attendant l'Apocalypse
Il faut en revanche se tourner vers les historiens actuels pour faire la lumière sur le message originel de Mahomet et le public qu’il visait. Mohammed Ali Amir-Moezzi dessine les contours d’une prédication initialement toute tournée vers la fin prochaine du monde et une communauté hétéroclite rassemblée autour du dieu unique:
"On sait très peu de choses réellement sur Mahomet, que c’était un prophète arabe de cette période, qui avait au début de sa carrière un message apocalyptique. Il disait trois choses, acceptables par tous: unicité de Dieu, prophétisme, jugement dernier."
Également auteur du Coran silencieux et le Coran parlant, notre interlocuteur tempère cependant ce tableau par l’évocation d’une possible évolution personnelle de Mahomet sur la survenue de l’Apocalypse: "Mais le temps passe et la fin n’arrive pas. On peut imaginer qu’il a alors infléchi son discours. (...) Jusqu’à la fin, Il reste quelqu’un qui croit à la fin proche mais peut-être pas imminente." Toutefois, le virage se pense aussi collectivement via la réécriture. Et Antoine Borrut souligne que l’islam n’a pas l’exclusive de ce procédé: "La biographie d’un fondateur de religion est toujours difficile car une religion arrivée à maturité réécrit généralement ses origines."
Ce que nous pouvons savoir de Mahomet
Tout ça ressemble à une fin de partie. Un prédicateur qui ne se montre que pour s’évanouir aussitôt sous les couches de réécriture, ne laissant derrière lui qu’un vague squelette de doctrine apocalyptique. Et rien de précis sur son état-civil, son quotidien, son caractère. La surprenante réplique de Gabriel Martinez-Gros à ce propos n’est pas de nature à nous rassurer:
"L’historien Jacques Le Goff avait écrit un gros livre sur Saint Louis où il prouvait que tout ce qu’on croyait savoir du roi de France provenait des textes préparés pour son dossier en canonisation et donc que tout était biaisé. Donc on lui disait: 'Mais donc on ne peut rien savoir du vrai Saint Louis?' 'On dit qu'il aimait le poisson mais même ça je ne sais pas car le poisson c'est un symbole chrétien’, avait-il répondu mais il avait ajouté : ’ Bon... Il aimait les fraises, or là je ne vois vraiment pas le sens qu'on pourrait en donner'." Gabriel Martinez-Gros insiste: "On ne peut être sûr que d'éléments dont on ne voit pas le sens."
Il tente alors de rejoindre quelques traits du portrait de Mahomet. "Il y a des petites choses de la vie quotidienne: il aimait les chats, il aimait les femmes, il avait pour elles une véritable tendresse. On savait qu'il avait une façon très étrange de se retourner quand on l'appelait: il se retournait tout d'un bloc, il ne tournait pas seulement la tête. Ce sont des choses de ce genre dont on peut être assez sûrs", brosse l’auteur de L’empire islamique.
Il paraît inconsidéré d’aller plus loin à ce stade. On peut même craindre que, quatorze siècles après la mort du fondateur de l’islam, sa biographie en bonne et due forme reste impossible. Ce serait cependant conclure trop rapidement: archéologues et historiens ne cessent de faire des trouvailles en Arabie et au Proche-Orient. Certaines d’entre elles permettront peut-être un jour d’affiner le coup de pinceau.















