"Hellphone", la comédie incomprise du réalisateur de "Brice de Nice" sur un portable tueur d'ados
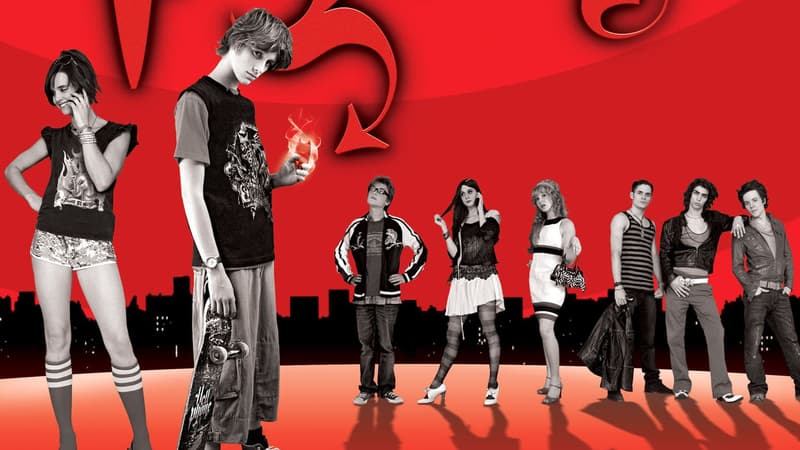
Détail de l'affiche du film "Hellphone" de James Huth - Studio Canal
"Au cinéma, il faut oser." Ce mantra, James Huth l'a répété des dizaines de fois sur le plateau de Hellphone. Cette comédie sortie en 2007, sur un téléphone portable tueur, avec Jean-Baptiste Maunier des Choristes en tête d'affiche, ne manque pas d'audace et d'inventivité.
Parabole sur le paraître et la pression du groupe doublée d'une réflexion sur l'emprise de la technologie, Hellphone mêle humour et horreur dans un teen movie à l'esthétique cartoonesque. "Si on prétend vouloir divertir les gens, il faut prendre des risques pour offrir quelque chose de différent", lance James Huth. "Oui, il faut oser!"
Hellphone reste pour lui un souvenir impérissable. "On adore d'autant plus ce film qu'il n'a pas fait tant d'entrées que ça." "C'est vraiment un film qui nous est cher", renchérit son directeur de la photographie Stéphane Le Parc. "J'ai fait des films qui ont très bien marché, mais je n'ai pas pour eux le même amour que je peux avoir pour Hellphone."
Fausse piste
2004. Alors qu'il vient de séduire plus de 4,4 millions de spectateurs avec Brice de Nice, une délirante comédie sur un surfeur qui attend une vague géante à Nice, James Huth peine à trouver son nouveau projet. Son projet d'adaptation de la BD La Marque Jaune avec Hugh Jackman, Philip Seymour Hoffman et Gong Li a capoté.
Une autre idée plus singulière de polar psychologique avec Jean Dujardin en psychiatre est elle aussi retoquée. "On nous a dit qu'on était fou. On leur avait apporté trop d'argent avec Brice. Ils nous ont dit: 'Revenez avec de la comédie ou ne revenez pas, les gars.' Je n'avais pas carte blanche sur tout!"
James Huth décide de s'approprier le teen movie. "J'avais envie depuis longtemps de faire un film sur cette période où on est au lycée, sensible au regard des autres, où on commence à dire des choses qui ne sont pas les nôtres, comment ça peut agir sur notre personnalité d’une façon plus profonde que l'on croit."
Une envie qu'il mêle à celle de parler de l'explosion du portable dans les écoles. "C'était l'époque où on a pris conscience que l'objet qui a le plus changé les comportements humains depuis le début de l’humanité est le téléphone portable. On en était encore au début de l’emprise de cette machine incroyable", se souvient le réalisateur.
Huth développe le concept avec le scénariste Jean-Baptiste Andréa. Le scénario est construit sur le principe de la fausse piste: après un début dans la pure tradition des teen movies, l'histoire dérape en film d'horreur. "J'aime beaucoup les extrêmes", indique James Huth. "La peur et l'horreur se marient formidablement bien avec le rire."
Un plagiat de Takashi Miike?
L'histoire est simple: en terminale dans un lycée parisien, Sid rêve d'un téléphone portable pour séduire Angie. Mais le téléphone qu'il achète dans un bazar chinois possède d'étranges pouvoirs: jaloux et protecteur, l'engin commence par vouloir se débarrasser de ceux qui lui veulent du mal, puis s'en prend à ses proches.
Le concept ressemble à s'y méprendre à celui de La Mort en ligne (2003) de Takashi Miike. "C'est un pur hasard", assure James Huth. "Je ne l'avais pas vu à l'époque." Ses références lorgnent plutôt du côté du cinéma fantastique (Christine, Gremlins) et des comédies décalées (L'Homme aux deux cerveaux avec Steve Martin).
Huth glisse aussi des références personnelles. Le Poulet Fritz, restaurant de poulet frit où Syd a ses habitudes, est un clin d'œil à ses cousins d'Amérique. Le Beau Danube Bleu, musique de bal de la cour de l'Empire d'Autriche-Hongrie qui résonne au Poulet Fritz, est un hommage à sa grand-mère originaire de Hongrie.
"Skywalker des temps modernes"
Pour trouver Sid, son "Skywalker des temps modernes", James Huth voit "toute la génération des acteurs français, suisses et belges entre 16 et 23 ans": "On a fait un casting de fou." Sur une suggestion du compositeur Bruno Coulais, il trouve la perle rare en Jean-Baptiste Maunier, révélé par Les Choristes.

L'adolescent de 15 ans, qui vient d'enchaîner plusieurs films d'époque, est aussitôt séduit: "On ne m'avait jamais proposé ça et c'était ça qui me plaisait. Ça me permettait de faire un film contemporain et moderne. Quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça très drôle. Puis on sortait de la folie Brice de Nice dont j'étais fan."
"Il avait tout ce dont notre héros avait besoin: la grâce, le charme, l'innocence", s'exclame James Huth, qui donne aussi sa chance à deux actrices désormais de premier plan: Anaïs Demoustier et Judith Chemla. Il voit aussi défiler au casting Léa Seydoux, qui n'aura pas le rôle ("Mais elle était exceptionnelle", précise-t-il).
Précurseur de l'iPhone
Avant le tournage, un défi se pose: trouver le design du Hellphone et s'assurer de son intemporalité. "C'est une de mes psychiatries", sourit James Huth. "Je cherche à ce que mes films puissent être vus des années sans avoir trop bougé. C'était un pari infaisable, parce qu'on parlait de portable - le truc qui se démode le plus vite au monde."
Il est épaulé par le dessinateur Stéphane Levallois, avec qui il avait travaillé sur La Marque jaune. "J'ai eu très vite l'idée d'une tête de diable", raconte ce dernier. "Je lui ai proposé une forme avec des petites cornes, un peu comme deux petites antennes."
La difficulté principale est de l'humaniser et de lui créer un visage. "On voulait terminer ce téléphone en pointe pour en faire à la fois une tête de diable, un masque africain et une tête de chat. James a tout de suite rebondi en proposant que dans l'écran puissent apparaître comme des yeux rouges."
Ils renoncent à un téléphone à clapet et privilégient un design simple et classique proche de celui de l'iPhone, pas encore inventé. "J'avais réfléchi à la forme des touches pour les insérer dans le corps du téléphone", se souvient Stéphane Levallois. "C'est James qui a dit: 'Pas de touche, le futur sera tactile'. Il a eu raison!"
Un des meilleurs tournages
Le tournage se déroule dans l'enceinte du lycée Henri IV à Paris "dans une énergie vraiment superbe", se souvient le directeur de la photographie Stéphane Le Parc. "C'est l'un des meilleurs tournages que j'ai faits", confirme Jean-Baptiste Maunier. "Ma famille était là, mes amis d'enfance, les amis du réalisateur."

Avec 50 jours de tournage, Jean-Baptiste Maunier est "de toutes les scènes, de tous les plans et de tous les axes". Avant le tournage, il répète inlassablement ses scènes avec les autres comédiens et un coach "pour arriver confiant sur le plateau". Malgré l'immense succès des Choristes, il ne laisse pas la pression l'envahir:
"Sinon j'allais me faire bouffer", précise-t-il. "Pour moi, je vivais une aventure. On me permettait de faire des cascades, de me battre, de vivre des choses que je ne pourrais jamais vivre. La pression peut-être était là, mais je ne me la posais pas. Je me donnais corps et âme."
Pour les besoins du tournage, l'adolescent passe en effet une journée dans une boîte de strip-tease (sous le regard de ses parents) et a la possibilité de conduire une AC Cobra, mythique voiture de sport des années 1960-1970. "C'était assez cool de pouvoir conduire ça quand on est à 16 ans en conduite accompagnée."
Maunier mue
Face à Jean Dujardin, grimé en version brune de Brice de Nice, l'adolescent peine à garder son sérieux. "C'était la scène la plus difficile à tourner pour moi. Dès que j'étais en contrechamp, ce n'était pas possible de m'avoir en amorce. Je rigolais trop. On voyait mes épaules bouger. Je n'arrivais pas à m'arrêter."
Pendant le tournage, Jean-Baptiste Maunier mue et prend 20 cm. "C'était un peu galère. J'étais en pleine transition. En pleine crise d'ado. Les vêtements ne m'allaient plus une semaine sur l'autre. Il y avait des retouches toutes les semaines. Ma voix devenait beaucoup plus grave."
James Huth, qui avait eu une brève carrière de chirurgien-dentiste, est par ailleurs aux petits soins avec son équipe. "Sur Hellphone, j'ai vacciné deux ou trois personnes contre le tétanos", révèle-t-il. Il soigne aussi Judith Chemla qui s'entaille le bras sur le tournage d'une des dernières scènes.
"Il me reste de ce film une cicatrice à la main", nous avait-elle raconté en 2021. "Il y a une scène à la fin où mon personnage se suicide. Pour bien le jouer, je laissais glisser le couteau et ça m'avait entaillé la main. [...] James Huth m'a recousue sur le tournage."
Un laboratoire
Dans Hellphone, l'humour vient des cadrages astucieusement choisis par James Huth. Le réalisateur multiplie plongées et contre-plongées et abuse des courtes focales pour tordre la réalité. "Chaque gag a son propre rythme", analyse-t-il. "Tout dépend de comment tu amènes le moment du rire. C’est une association de plans."
Hellphone compte plus de 2.000 plans. Pour rendre ses gags les plus efficaces possibles, Huth réfléchit méthodiquement à sa mise en scène et s'inspire notamment du cinéma russe d'avant-garde (Quand passent les cigognes, Soleil trompeur), mais aussi de l'expressionnisme allemand des années 1920.
"Ce film a été un laboratoire pour nous", dit Stéphane Le Parc. "On s'est vraiment lâchés. Comme James sortait d'un succès, on a pu essayer plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autrement. Quand il avait une idée, je rebondissais. Son cerveau va tellement vite qu'il a quinze idées à la seconde."
"Il y a tellement d'inventions dans Hellphone que ça pourrait être une banque d'idées d'images", renchérit Stéphane Le Parc. "Des idées qui sont dedans ont été reprises ensuite par d'autres réalisateurs. Le plan dans le commissariat où la lumière s'éteint et reste juste sur le comédien, je l'ai revu ensuite retravaillé dans des films de Dupontel."
Bouts de scotch et bouts de ficelle
James Huth dispose d'un budget modeste - à peine 5,7 millions d'euros (et non 7,4 millions, comme cela a été écrit par erreur) - pour donner vie à son imaginaire baroque. Fou du cinéma de Méliès et de son art du trucage, il privilégie les effets spéciaux en direct sur le tournage:
"On savait que c’était un film particulier. Il aurait été fait aux Etats-Unis, il aurait coûté six fois plus d'argent. Et tout aurait fonctionné. Nous, rien ne fonctionnait. C'est fait avec des bouts de scotch et des bouts de ficelle."
À l'écran, Huth construit un univers hors du temps avec un code couleur très marqué, qui permet d'éviter la violence. "Le rouge était censé schématiser l'enfer et l'amour", décrypte Stéphane Le Parc. "Au fur et à mesure du film, le rouge prenait de plus en plus de place. Dès que le héros obtient ce téléphone diabolique, le rouge devient fort."
Hellphone s'adresse avant tout aux 12-14 ans, insiste James Huth: "J'ai fait gaffe à la présence de la violence et du sang dans le film et à toujours privilégier la comédie. J'ai hésité au moment où Judith [Chemla] se tue. Il n'y a pas un gramme de sang. On est hyper faux, mais je préfère montrer moins que plus."
"Une vraie déception"
Le 28 mars 2007, jour de sortie, les critiques sont mitigées, voire négatives. "Le film est réalisé un peu n'importe comment, mais avec un tel amour du détail qu'il en devient franchement sympathique", écrit ainsi Le Monde, qui déplore un humour "guère désopilant" et un film "regrettablement frileux".
Seulement 288.288 spectateurs se laissent séduire. "Un bide total. On s'est pris une baffe", se souvient le producteur Nicolas Altmayer. "Les projections test étaient super. Le distributeur nous avait dit: 'Si je ne fais pas 2 millions avec ce film, je suis vraiment nul!'. Puis on avait vu lors des avant-premières en province des salles pas pleines."
"Ça a été une vraie déception", confirme Stéphane Le Parc. "À l'époque, j'habitais aux Halles. J'allais tous les jours acheter des tickets pour faire des entrées! Dans ces cas-là, on pense qu'acheter dix tickets par jour va faire que les gens vont y aller, mais finalement ils n'y sont pas allés!"
"C'était un film très spécial", reconnaît-il. "Des teen movies qui dérapent dans l''horreur, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait pas vraiment de public pour un film comme celui-là. C'était un film tellement différent des Choristes qu'il y avait une chance sur 100 que ça marche."
Trop avant-gardiste?
Pour fonctionner en salles, un film aussi atypique que Hellphone dépend du bouche-à-oreille. "Et il n'a pas pris", regrette James Huth. "On aurait peut-être dû avoir un titre qui soit plus accrocheur en France - déjà pour indiquer que c'était un film et pas un produit. Il aurait peut-être fallu le franciser, mais on n'a jamais trouvé."

Il lui est en réalité impossible d'expliquer l'échec du film. "Il n'y a pas de règle au cinéma. Rien n'est joué d’avance. Ça fait partie de la magie de ce métier-là." James Huth reste heureux d'avoir fait un film unique en son genre et accepte avec philosophie les critiques virulentes suscitées par son film:
"Je remercie tous les gens qui m'ont critiqué et qui continueront à le faire, parce que ça veut dire qu’ils ont pour certains vu le film. Il ne faut pas se trahir. Il ne faut pas essayer de plaire à tout prix. Il faut être sincère, aller jusqu’au bout de son œuvre et faire en sorte qu'elle soit la plus réussie et la plus cohérente possible."
Hellphone était peut-être trop visionnaire, estime de son côté Jean-Baptiste Maunier. "Il était trop avant-gardiste ou trop américain pour le public français. Il a eu une vie après. J'ai l'impression que le film est devenu un peu culte en underground. Beaucoup de gens de mon âge me parlent beaucoup de ce film."
Après Hellphone, Jean-Baptiste Maunier délaissera le cinéma. À 18 ans, il s'envole pour New York. "J'avais besoin de me former, de découvrir des choses. J'avais l'impression d'avoir grandi très vite grâce à ce métier et que je n'avais pas vraiment vécu mon adolescence. Je voulais apprendre depuis le début, tout recommencer."
Retrouvez l'intégralité de la série "Dans les coulisses des comédies françaises" dans notre dossier. Notre podcast original Comédies Club est disponible sur toutes les plateformes.















