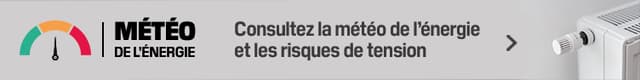Pour en finir avec les énergies fossiles, faudra-t-il en passer par la taxe carbone?
Un compromis qualifié d’historique. Après une nuit de prolongation, les pays du monde entier se sont accordés à la COP28 de Dubaï sur l’abandon progressif des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. Le texte appelle à "transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques".
Chaque pays reste bien entendu libre des moyens à mettre en œuvre pour contribuer à atteindre ces objectifs. Les instruments dont disposent les pouvoirs publics sont de toute façon limités et se résument généralement à un arbitrage entre hausse de la fiscalité écologique (taxe carbone) et subventions aux énergies vertes. Mais existe-t-il une méthode plus efficace que l’autre pour accélérer la transition?
"Il n’y a pas de consensus sur une méthode miracle pour arriver au résultat", expliquait Lionel Fontagné, conseiller scientifique au Cepii (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), lors du Printemps de l’économie. Les citoyens, eux, ont une préférence. En France, la crise des gilets jaunes a démontré le faible soutien de la population à la taxe carbone. Une étude comparative menée en 2016 et relayée par l’OFCE révélait que l’Hexagone, avec 20% de sondés favorables, affichait un des niveaux les plus bas d’approbation à la taxe, alors qu’ils étaient 60% en Suède. À l’inverse, les subventions recueillent l'assentiment de tous les pays européens avec des taux de soutien compris entre 60 et 90% (75% en France).
La taxe carbone, "instrument de référence"
Les économistes ne sont pas vraiment du même avis. Si les citoyens ne la voient pas toujours d’un bon œil, la fiscalité environnementale, à travers l’introduction d'une taxe carbone par exemple, est le "meilleur instrument" de lutte contre le réchauffement climatique en termes de balance coût-efficacité "car elle permet d’atteindre tout objectif de réduction d’émissions au moindre coût et laisse aux agents privés, ménages et entreprises, le choix de la mise en œuvre et de la quantité de réduction d’émission", contrairement aux réglementations, tranchait le Conseil d’analyse économique (CAE) en 2019. Sans compter que la taxe carbone "stimule l’investissement vert et l’innovation en procurant un ‘business model’ aux projets verts".
Un avis partagé par Mireille Chiroleu-Assouline, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne qui rappelle dans une étude pour l’OFCE qu’"aux yeux des économistes de l’environnement, la fiscalité sur les énergies fossiles (…) est l’instrument de politique climatique de référence, préférable aux autres instruments économiques comme les subventions, ou réglementaires telles les interdictions".
La taxe carbone dispose en effet de nombreux avantages. D’abord, elle est en phase avec le principe "pollueur-payeur" puisque plus une entreprise émet du CO2, plus elle devra payer. Elle conduit de surcroît à augmenter le prix des énergies fossiles, ce qui incitent aussi bien les consommateurs que les entreprises à se détourner des produits carbonés, soit en limitant leur consommation, soit en se tournant vers des produits de substitution plus propres lorsqu’ils existent. Et contrairement au marché de quotas d’émissions, "une taxe carbone fournit un signal-prix stable, clair et certain" sur plusieurs années et permet dès lors aux entreprises et aux ménages de mieux anticiper et de "prendre leurs décisions d’investissement rationnellement", ajoute Mireille Chiroleu-Assouline.
L’efficacité de la taxe carbone a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions du monde, selon les économistes, comme le rappelle Mireille Chiroleu-Assouline. Dans la province canadienne de Colombie-Britannique qui l’a mise en place en 2008, la baisse des émissions a été estimée entre 11 et 16%.
Le Carbon Price Floor (CPF) introduit au Royaume-Uni aurait également permis de réduire les émissions du secteur de l’électricité de 20 à 26% par an entre 2013 et 2017. Même constat en Suède où la taxe carbone aurait diminué les émissions de 6,3% par an en moyenne depuis 1991, ainsi qu’en Finlande où les émissions des secteurs des transports ont été inférieures de 31% en 2005, 14 ans après l’instauration d’une taxe carbone, par rapport à la situation dans laquelle elle n’aurait pas été appliquée.
Les experts du CAE pointent un autre avantage de la taxe carbone: contrairement à une subvention, "elle évite l’usage plus intensif des matériels plus performants, qui réduit en général l’impact sur les émissions des aides à leur achat". Par exemple, un particulier qui avait l’habitude de ne chauffer que quelques pièces de son logement avec un chauffage très énergivore pourrait être incité à chauffer toutes les pièces en acquérant un équipement plus performant subventionné. Les économies d’énergie seraient dès lors moindres qu’espéré.
La taxe carbone efficace à condition d’être acceptée
La principale difficulté avec la taxe carbone est de la faire accepter par la population. Si elle a connu les événements des gilets jaunes, "la France n’est en fait pas le seul pays à avoir expérimenté un refus aussi net de la taxe carbone. Les mesures de fiscalité carbone font l’objet d’un large rejet dans certains pays qui ont pris des engagements significatifs lors des Accords de Paris, renouvelés ou approfondis lors de la COP26 à Galway en 2021", souligne Mireille Chiroleu-Assouline.
L’instrument est souvent perçu comme inégalitaire, frappant davantage les ménages aux revenus les plus faibles. Ce qui est effectivement le cas lorsqu’il ne s’accompagne pas d’une politique de redistribution bien calibrée. Mais elle peut être acceptée lorsque les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour compenser son impact sur le pouvoir d’achat des plus modestes. En Colombie-Britannique, la tarification fédérale du carbone introduite en 2019, onze ans après la taxe carbone, a été relativement bien accueillie par les électeurs. De fait, les recettes de cette taxe "sont remboursées aux contribuables sous la forme d’un crédit d’impôt afin de compenser l’augmentation du coût de la vie", précise encore Mireille Chiroleu-Assouline.
Certains économistes rappellent toutefois que la mise en place d’une taxe carbone peut se heurter à d’autres difficultés qui réduisent son efficacité, comme le manque de produits de substitution décarbonés ou "leur inaccessibilité en raison de leur coût prohibitif". En Europe, le système de taxe carbone appliquée sur les importations de produits polluants qui va s'appliquer progressivement est aussi accusé de nuire à la compétitivité en renchérissant les coûts pour les entreprises du Vieux Continent qui dépendent de composants importés pour produire. Pour cette raison, le CAE préconise d’utiliser les nouvelles recettes pour accompagner les secteurs touchés.
Le difficile ciblage des subventions
Les subventions doivent-elles pour autant être écartées? Pas nécessairement. Financer la transition écologique à grand renfort d’aides publiques est souhaitable notamment quand il s’agit de subventionner "temporairement la recherche verte car il est plus facile d’innover dans les secteurs où le stock de connaissances est déjà important", relève le CAE. Les subventions doivent également permettre "d’orienter la recherche et l’innovation vers les technologies de rupture à plus fort potentiel".
Reste que le seul recours aux subventions pour verdir l’économie n’est pas la méthode la plus recommandée, au regard de son coût souvent énorme, et de son résultat pas toujours optimal. Les subventions ont en effet quelques inconvénients: elles permettent "à des structures socialement non productives de rester en place quand on voudrait permettre l’émergence de nouvelles filières", déplorent les économistes du CAE. Par ailleurs, leur ciblage n’est pas toujours évident, ce qui se traduit parfois par des effets d’aubaine et un gaspillage d’argent public.
Les politiques climatiques basées sur les subventions ont également tendance à profiter davantage aux ménages aisés qui peuvent changer d’équipements plus facilement, si bien qu’ils deviennent les premiers bénéficiaires des aides versées dans conditions de revenus.
Surtout, si elles incitent à se tourner vers les énergies vertes, les subventions ne pénalisent pas l’économie "brune", rappelait il y a quelques mois Agnès Bénassy-Quéré, sous-gouverneure de la Banque de France, auprès de l'AFP. Autrement dit, financer le développement des énergies renouvelables n'a pas nécessairement d'impact sur la consommation d'énergies fossiles, plus polluantes mais parfois privilégiées par les consommateurs pour leur moindre coût. Et "si tous les pays du monde adoptent la stratégie américaine d'investissement public et de subventions à l'investissement privé, on risque d'avoir une hausse des taux d'intérêt au niveau mondial", mettait en garde Agnès Bénassy-Quéré, ce qui renchérira in fine les investissements dans la décarbonation.
Un mix "taxe carbone-subventions"
Au final, le Conseil d’analyse économique préconise plutôt un "mix d’instruments", avec à la fois une taxe carbone pour stimuler l’innovation verte et, en complément, un soutien à l’innovation et à l’investissement vert sur fonds publics. "Il s’agit d’une politique complémentaire à la politique de taxation", affirme-t-il.
Dans une étude publiée récemment, des économistes de la Banque de France ont imaginé quatre scénarios possibles de décarbonation et mesuré leur impact respectif sur l'inflation et la croissance dans l'Hexagone. Au bout de cinq ans, le scénario de "forte hausse de l'investissement privé" grâce à des subventions "réparties de manière optimale" et financées par une hausse d'impôts produit les effets les plus favorables: l'inflation est inférieure de près d'un point à celle qui aurait été constatée en l'absence d'investissements privés, et la croissance supérieure de près d'un point de PIB, selon l'étude.
Si certains assurent que les subventions peuvent être financées par les recettes de la taxe carbone, le CAE estime toutefois qu’elles n’ont "aucune raison" de l’être. Et pour cause, si une part des recettes de la fiscalité du carbone "était fléchée vers ce financement, elle deviendrait alors presque autant un instrument de rendement qu’un instrument servant le seul objectif d’orienter les comportements privés".